LES LIVRES DES AUTRES
OLIMPIA
Céline Minard
Éditions Denoël
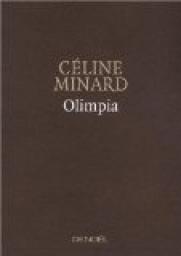
Olimpia ça s’appelle. Il s’agit d’allumer un feu. Peu importe la qualité des branches. Longueur, diamètre, taux d’humidité ou de sécheresse on s’en fout. Il faut que ça flambe. Le principal, la source, l’étincelle a jailli et c’est parti. Et ça se consume d’un seul et même souffle alimenté qui n’a pas d’équivalence. Qui ne part pas d’un point pour aller à un autre, mais passera par tous les points possibles. Par un livre qui n’a pas de but, mais qui réinvente sans cesse son début. Par une phrase qui n’a pas de finalité, mais ramasse les coquillages, les bois flottés, les détritus et les saloperies abandonnées aux météores avant que de monter en l’air et de repartir avec la vague. Barrage hydroélectrique en altitude, chaque mot retient tous les autres avant de les lâcher aval comme le pet de l’ours, l’émission des gamètes de l’oursin, l’efflorescence de la viande de cerf sous l’emprise de la venaison. Ça brûle. Ça déchire. Ça envoie du bois. Ça boit le feu à la régalade et ça emporte le feu avec. Ça griffe les murs, ça arrache les chairs, ça suinte de partout et ça souffle en même temps sirocco et noroît. C’est de l’écriture impur jus. Un style hissé haut, tissé large, métissé fin de registres et de langues, de lectures sacrées et profanes, de livres anciens et de vocabulaires modernes. C’est l’Art du Roman dans toute sa splendeur. C’est tout ce qu’on n’a jamais lu ailleurs, et ne peut donc plus être oublié. L’écuyère est montée sur un pur-sang caparaçonné d’arts baroques. Elle a la flamme. Elle a les armes. Il s’agit d’allumer un feu qui commence avec un pétard et finit par incendie. On ne sait pas jusqu’où ça peut aller, mais on veut aller avec. C’est un livre de Céline Minard. Ça s’appelle. En plus, sa mère, il appert qu’elle en a écrit plein d’autres. Et le désir comme on sait, putain ça aussi ça brûle !
LE SEIN
Philip Roth
Éditions Gallimard

En forme de bouclier ou d’œuvre d’art. En guise de ciel anatomique pour l’étoile du cœur ou de point de fuite pour le regard amoureux. Il n’est peut-être rien de plus admirable ni de plus admiré chez l’être humain que sa poitrine à la fois creuse et pleine, symboliquement située au contact de l’air et du sang, de l’hier et du demain, de la vie et de la mort comme le chanta jadis Rainer Maria Rilke dans son éloge du Torse archaïque d’Apollon. Plus loin, en 1963, le Professeur Charles-Marie Gros invente une science nouvelle : La Sénologie. Il veut ainsi combler un manque, et désigner ainsi une pathologie qu’il estime au carrefour de la clinique, de l’imagerie, de la radiothérapie, de la cancérologie, de la chirurgie, de la gynécologie, de l’endocrinologie, de l’immunothérapie et de la psychiatrie médicale. À sa manière et à l’autre bout du royaume fictionnel, dans tout ou partie de son œuvre Philip Roth aura, quant à lui, aimé, vénéré et décrite cette même partie de l’anatomie humaine qui, selon le dictionnaire « s'étend de la base du cou jusqu'au creux de l'estomac » mais surtout s’avère être l’endroit où « se trouvent situées les mamelles ». Objet de fascination autant que d’ardeur, la mamelle féminine était donc digne — au-delà des blasons poétiques — d’être un jour ou l’autre élevé au rang de personnage romanesque, et de prendre la parole.
Riche en réflexivité critique autant qu’en auto-analyse comique, Ph. Roth n’était-il pas le mieux placé pour s’y coller, et pour passer ainsi à la question cette humaine trop humaine adoration que, du berceau jusqu’au tombeau, Hommes ou Femmes partageons tous plus ou moins ? Toujours turgescent d’imagination autant que d’ironie, nul doute que l’auteur de Portnoy ne chercha pas longtemps l’outil narratif parfait pour assouvir son désir de (se) comprendre à savoir : une métamorphose. Transformé en glande mammaire géante du fait d’un « afflux massif d’hormones », le professeur de littérature et de désir David Kepesh se retrouve suspendu par des lanières de velours dans le cube anomique d’une une chambre d’hôpital new-yorkaise. Par un effet de réel relevant du pathologique comme du philtre littéraire, son corps est soudainement versé dans l’enveloppe charnelle de l’objet de toutes les envies. Il ne sera bientôt plus que pure pulsion, organe central, sensible, sensitif et frustratif à la fois. Doué d’une conscience inchangée, David-le-sein n’est plus qu’érotisme, que toucher, caresse et infinies sensations. Être métabolisé en pénis eût été trop simple. Trop facile, trop évident peut-être…
Dans ce conte surréaliste digne d’un film de Federico Fellini, Ph. Roth ne nous invite pas, il nous force à voir le monde depuis le désir masculin, en tramant les fils de ses amours comme de ses désamours — le Grand Guignol du mariage — dont, comme chacun sait, l’amitié fait partie. Grâce à une focalisation interne habilement menée, il atteint le sein des seins par l’art kafkaïen de la métamorphose où il ne s’agit pas tant de changement d’identité ou de basculement vers l’altérité, que de fusion des deux en une mètis aventureuse où les termes du paradoxe masculin versent l’un dans l’autre comme les boules d’un sablier. Paru aux États-Unis en 1972 et poursuivi par Professeur De désir d’abord, et par La Bête qui meurt ensuite, Le Sein est le premier volet de ce qu’on appelle communément le cycle de David Kepesh. Chez Roth, écrire c’est aussi changer de point de vue. C’est changer d’avis voire, changer de vie. Sans s’égarer trop ni faire injure à l’auteur, on peut estimer que, ce faisant, il aura été à la littérature ce que Charles-Marie Gros fut à la médecine, à savoir : l’inventeur d’un nouveau genre : La Désirologie.
MA TEMPÊTE
Éric Pessan
Aux Forges de Vulcain

Dans un chapitre célèbre des Misérables — mais ne le sont-ils pas tous ? — Jean Valjean est confronté à une question morale qui remet en cause comme en conséquence tous les épisodes précédents de son existence. L’espace d’une nuit, dans un maelström mental échappé du plus puissant des personnages de Shakespeare, intitulé « Tempête sous un crâne » le texte hugolien roule thèses et antithèses, questions et réponses, pensées claires et sombres souvenirs sur la scène ouverte de son esprit torturé. Le personnage du nouveau roman d’Éric Pessan David, rejoue la scène hugolienne sous les mêmes auspices shakespeariens. Aux prises avec une situation professionnelle amère, il va répondre par la maturation d’une créativité ; fût-elle aussi infime qu’intime. À l’adversité, il opposera la poésie. A la dure réalité, la force de sa vérité. De son projet artistique avorté il accouchera un sujet ambitieux. De l’échec mortifiant il fera un éloge de pensée.
Ma Tempête est l’anamnèse mélancolique d’un créateur, metteur en scène qui, défie son échec à coups de monologue réflexif, poétique et politique. Ce qu’il a sur le cœur nous est rien moins que commun, et essentiel, même s’il n’oublie rien ni personne ; à commencer par lui-même. Mais sa revanche, David la veut douce, lente, rhapsodique. Elle aura lieu malgré tout, dans le confort précaire du foyer, malgré une météo menaçante et une situation familiale au bord des météores. Face aux politiques culturelles contrariantes, David jouera sa pièce avec une couverture, une paire de coussins, une poupée et un nounours. Déroulant pour le lecteur les actes, les actions et les personnages shakespeariens qu’il avait en tête voire, les extraits audio de sa prime tentative enregistrés, il prend la vie à témoin. La vie s’appelle Miranda, et elle a deux ans et demi. Face au plus vif, au plus sensible, au plus important, l’auteur bafoué va métaboliser sa tempête existentielle en spectacle pour enfants.
On sait que les enfants savant tout. Qu’ils comprennent tout. Et que ce qu’ils ne comprennent pas ils le prennent en compte. Parce qu’ils n’ont pas de filtre. Parce qu’ils n’ont pas encore de masque. Parce qu’ils n’ont presque pas de mémoire. Toutes choses, paradoxalement propres au théâtre… Dans ce beau, fin et fort roman, toute personne qui écrit peu ou prou devinera, ressentira ou trouvera des signaux, des points de fuite, des éclairs et des coups de vent salutaires dignes d’être chantés. On peut mordre la poussière en y voyant briller le grain des étoiles. Il arrive que la pluie soit réversible.
QUELQUES MOMENTS SANS GRAVITÉ
Karin Serres
Alma éditeur

On ne connaît jamais personne. Les êtres humains sont des énigmes pour le reste du genre. Leur venue au monde comme leur disparition nous demeure énigmatique, qui poudroie le ciel et la terre de reflets paradoxaux qui se frottent, s’échauffent, se déforment et parfois s’annulent. Les êtres humains sont légion et, la chose principale qui les rassemble demeure — quadrupèdes et oiseaux, bourgeons printaniers et soirs d’été, chapeaux de messieurs et chemisiers de dames — qu’ils se ressemblent. Leurs silhouettes se répètent. Leurs différences les communautarisent et le hasard les éprouve. Les rues de nos villes en attestent. Ainsi les terrasses des cafés. Les nuées des transports en commun. Les files au supermarché… On ne les connaît pas, ces « gens-là ». Y compris ceux que l’on croit connaître. Y compris ceux qui nous aiment, disent ou veulent nous connaître. Ceux que l’on rencontre, qui nous traversent et nous métamorphosent. Ces personnes, ces entités complexes, ces autres réitérés partagent avec nous le même trouble existentiel de ne quasi rien comprendre à presque tout le monde et ce, jusqu’à l’absurde. Ils tombent. Ils tombent tout droit dans le champ de nos vies comme autant de poissons dans une opacité de vieux aquariums. De petits poissons, monochromes, dans de petits paniers de verre, transitoires et brisés. Que se passe-t-il dans la tête de celle qui, des heures durant, regarde la rue à travers la fenêtre ? Que se passe-t-il dans le crâne de celui qui nous convoque dans son bureau ? Que se passe-t-il dans la caboche de celui ou celle qui offre un cadeau sans raison ? Où filent les actes commis et les pensées amuïes ? Où sont les corps qu’on ne voit plus ? Où vont les disparus ? Dans quels limbes déploient-ils leurs gestes fantômes ? Notre existence pleut sur nous comme une averse d’été. Elle verse et nous traverse en même temps. Elle couvre et nous découvre en même temps. Elle tombe verticalement comme les graines-secondes du Grand Sablier. Ce temps gisant au cœur de l’attente est comme le bon génie recroquevillé dans la lampe magique. Capable du pire comme du meilleur. Conspirateur du doute autant que de la persévérance. Sœur jumelle du rêve nocturne, yeux et pores grands ouverts, la rêverie diurne est une autre forme d’attente qui fomente les idées comme d’autres taillent des pierres précieuses. Avec l’instinct du personnage de conte capable de métaboliser ses dilemmes ontologiques en superpouvoirs mesurés, l’esprit humain cinématise les images présentes comme il polie les souvenirs du futur. Il voit à travers les choses. Entre les lignes nos histoires tantôt remplies tantôt filigranées de force, de faiblesse, de joie, de mélancolie, de ferveur et de prohibition. Ce n’est pas tant que toute chose ou toute personne soit fiction, mais presque. Ce n’est pas tant que le fantastique soit partout (autrement dit nulle part), mais presque. Ce n’est pas tant que nous soyons tous romanciers mais… Il paraît que nous aurions fâcheuse tendance (felix culpa) à ce que le spécialiste appelle « Roman familial ». Un ici qui est aussi un ailleurs, et où l’activation des zones troubles de l’esprit les pousse à s’éclairer elles-mêmes face aux questions enfantines sans mensonge : Qui suis-je ? Que fais-je ici ? Mes parents sont-ils mes parents ? Pourquoi ne suis-je pas né en Amérique ou Inde, dans l’état de l’Uttar ou de l’Andra Pradesh, ou mieux à Golkonda ? Là où les diamants ont la transparence parfaite et féconde de la pluie… Notre imagination, c’est l’or du temps. L’or de l’espace et du temps qui nous permet de cerner l’inconcevable univers, en faisant face à la 19ème marche d’un escalier de la rue Garay, à Buenos Aires, en 1941. Ou de tenter le déchiffrement de l’écriture de Dieu à travers les ocelles d’un jaguar, les feuilles mortes, les pièves d’un puzzle, la kabbalistique des listes de course… Ou bien d’attendre la vie, comme d’autres attendre la mort puisque que, attendre, c’est toujours « tendre à ». Le manque suprême, la divine absence, la disparition d’un être cher sont aussi des Graals… Les choses ne sont pas toujours ce que l’on croit, même lorsqu’elles sont graves. Il y a des merveilles, n’est-ce pas Aline ?
LA GRIMACE
Vincent Vanoli
L’Association

Se remet-on jamais de sa maison d'enfance ? De ses coins et recoins, de son orientation, de sa lumière comme de ses ombres, de ses plis, ses odeurs, ses grincements, ses bruits et ses voix familières dans l'escalier ? Se remet-on jamais du paysage par la fenêtre, fut-il des plus gris à l'ombre des dragons géants et fumants de l'industrie sidérurgique ? Reflété dans le miroir déformant de la mémoire individuelle et fragmentée, le regard introspectif ne saurait reproduire la passé, mais seulement l'interroger, quitte à lui tordre le bras — ou le nez . Ce n'est pas tant que c'était mieux avant, non ! c'est juste que c'était avant. Et que avant, on ne se posait pas la question. La nostalgie n'est pas de mise lorsqu'il s'agit de viser juste. Il ne s'agit plus de craindre les écarts et les dérives, pourvu que le porte-à-faux permette de se regarder en face. De mettre une cale en papier sous le pied du meuble.
Dans son dernier livre « La Grimace », Vincent Vanoli inverse la potentialité des organes. Faisant penser son cœur et battre son cerveau, il offre à son personnage fantomatique le masque clair-obscur de l'ange mélancolique de Dürer. Une vision tragique de l'Histoire barre son front blanc, colorant son regard depuis le noir le plus profond jusqu'à la lumière la plus crue : celle de la sincérité. Malgré des traits drolatiques, l'aventurier autobiographique de la mémoire passe alors à travers les épisodes comme d'autres à travers les murs, foulant la terre, le souffre, la crasse, les désirs et les saisons à ses pieds. La bataille était perdue d'avance. Malgré tous ses efforts, malgré la multiplication des reflets, le miroir comme son reflet ne réfléchiront jamais suffisamment la réalité. Que font ses bords ? Qu'y a-t-il dessus, dessous, derrière ? Paradoxalement, c'est peut-être lorsque le miroir se brise, que l'on peut se voir en entier.
Lorsqu'on se regarde dans un miroir, on se voit à l'envers. Comme si l'on gisait dans son propre cercueil. L'ange mémoriel de Vincent Vanoli cache une immonde grimace sous son visage quasi mythologique de « vieux-jeune-homme ». Jamais apaisée depuis l'enfance, c'est une figure de l'angoisse devenue principe de résistance. Si c'est sourire de travers, grimacer peut aussi s'avérer le meilleur moyen de défier le miroir. Un art de tromper joyeusement la mort. Qui sait, de redresser la vie ?
PAULOWNIA
Sylvie Bocqui
Éditions Arléa

Écrire c'est souvent l'absence. La confrontation avec l'absence. Le front contre son mur de verre. Se lever avec l'absence, prendre son café avec l'absence, sa douche avec l'absence, marcher avec elle, dormir et rêver avec elle. Une absence pleine, puissante, contondante. Une absence omniprésente qui creuse et qui rebondit, qui ouvre et qui ferme, qui emprisonne et qui libère. Les mots essaient de combler l'absence de mots. De boucher les trous de l'oubli et de la mémoire en même temps. Ils tournent en l'air comme des oiseaux de proie. Ils s'accrochent désespérément au ciel qui, parfois, les refuse.
« Elle garde son regard droit devant elle, ou au-dessus, si elle le baisse vers le sol, il va l'entraîner ; elle s'accroche aux arbres — leur nom ! vite ! —s'accroche aux fleurs, à une seule — son nom ! —, qui se détache et tombe au ralenti. »
Scarabée sur le dos. La charogne au sol éprouve des remuements sourds et mauves. Le nom, sur le bout de langue, est un trou noir qui absorbe tout ce qui passe à son entour. Ecrire c'est tourner. C'est autour et c'est dedans. C'est retourner les mots morts, les mots tombés, les mots oubliés. Soudain, à travers les ramures, un rayon de soleil épouse de manière têtue la courbe du soir. La courbe des mots. Les noms s'ouvrent comme des fleurs. Le scarabée repart comme un train. L'absence a trouvé sa place.
LORRAINE CŒUR D’ACIER
Tristan Thil & Vincent Bailly
Éditions Futuropolis

Aucune lecture n'est objective. Mais voilà le plus beau livre que j'ai lu cette année. Cette lecture m'a traversée comme un mouvement d'horloge, ses engrenages tragi-comiques et ses aiguilles déterministes dressées comme des épées de Damoclès. Par une alternance de cadrages et de dialogues sans concession qui concentrent ou dilatent la narration, le livre de Vincent Bailly et Tristan Thil est une asymptote à l'idéal, qui parvient à relier mémoires individuelles et grande histoire. Cette grande dame de fonte qui brandit parfois une grande hache en acier trempé de Longwy. L'histoire est un dragon couché sur un trésor, et ce trésor c'est notre mémoire conjuguée. C'est Nous.
LES SINGES ROUGES
Philippe Annocque
Quidam éditeur

Philippe Annocque n'en finira jamais de buter sur les mots comme d'autres sur d'inégaux pavés. Il doit manquer des touches à son clavier. Et les mots qui manquent il les fait donc siffler entre les lignes, entre les paragraphes, entre les "entre" eux-mêmes. Il les décrit comme d'autres font du crochet. Il fait des mailles autour du vide... Non ! autour de l'absence qui n'est pas la même chose que le vide. D'ailleurs, le vide n'existe pas. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et encore une à l'envers. Pourquoi ? Et pourquoi pas. De l'autre côté du motif gît et geint un autre motif que le motif-même. Un autre mot. Un autre trou de la mémoire. Une autre touche où appuyer même si ça fait mal. Est-ce qu'on hérite ses trous de mémoire. Est-ce qu'on hérite des trous de mémoire de ses ascendants, des trous de terre au milieu de la mer, des tombes anciennes et des chutes à venir ? Est-ce qu'en cherchant ses mots on cherche aussi bien ses morts ? Est-ce que les enfants ont toujours « au fond de la gorge quelque chose que les adultes n'ont plus et qu'ils veulent leur arracher » ? Je ne sais pas. Philippe Annocque non plus. Nous voilà bien reculés ? La mémoire est un verbe qui pousse sur l'oubli comme une fleur sur les ruines effondrées. Parfois, c'est un cri prolongé de la douleur la plus poignante... Parfois ce sont des cris mimant l'art du contrepoint. Là-bas, de l'autre côté de sa mère, les singes hurleurs n'ont pas besoin de haut-parleurs. Ils s'expriment directement dans les bouches. S'énoncent à travers les lèvres entrouvertes et mouillées. Ils se signalent en couleur, au bas des oaristys du crépuscule. Non, il n'y a pas de paradis perdu. Il n'y a que des paradis à écrire. Après, longtemps après, on ira vérifier tout ça sur Wilkipédia.
FINIR LES RESTES
Frédéric Fiolof
Quidam éditeur

L'amour, ça finit pas ça finit. Le deuil non plus, le deuil. C'est quoi au juste le « don des morts » ? Qui est-ce qui mord ? C'est où que ça fait mal ? Il n'y a pas qu'une seule et même manière d'aimer les siens. Une seule et même manière de vivre avec ses souvenirs. Une seule et même manière d'animer ses morts, de les retourner, de les placer encore et toujours face au soleil. La vie ne fait pas que des cadeaux, et l'amour des êtres mortels n'est pas des moindres. On le sait depuis toujours on le sait. Mais ça ne nous empêche pas, ça n'empêche rien. Il y des ifs ombrageux et des allées crissant de mâchefer tout autour des berceaux qui ondulent. Nous sommes tous des orphelins en germe nous sommes. Des faibles en puissance, des regrettés en devenir, des volontaires en diable. Mais l'amour des siens - parents, proches et enfants - eh bien non ça ne finit pas, ça finit. « On ne peut pas, dans un cœur, implanter une urne funéraire ». Non, on ne peut pas. Mais on peut l'écrire. On peut le décrire. Le désécrire même, et de colère briser l'urne. Et de plaisir en recoller les morceaux. On peut refaire, redonner, raconter. On peut compter et numéroter ses abattis. Numéroter ses mémorables. Une joie brille, au fin fond du mot impossible. Et il y a de la joie, dans la persévérance à vouloir l'écrire. A le poursuivre dans les coursives du cortex cet amour des siens. Notre amour des nôtres. Pas de réussite, pas d'échec non plus. Mais la trace et son ombre. La mémoire et l'oubli. La peine et la joie mêlées comme l'encre au papier. Et si le véritable don des morts n'était autre qu'offrir la possibilité d'un contredon ? Possibilité tel Orphée, de se retourner, de voir en face la vérité pour enfin parvenir à chanter. À ouvrir la bouche. À crier par-delà les tombeaux, de cordes et de lignes dénouées. Et si le don des morts c'était finir les restes ? Si écrire c’était rester. Rester pour commencer. Pour recommencer. Voilà ce que nous offre à lire, à ressentir et à penser le très beau et très émouvant nouveau livre de Frédéric Fiolof : Finir Les Restes, paru en ce début février aux éditions Quidam. Un livre qui délivre, et c'est très bien ainsi.
DAIMLER S'EN VA
Frédéric Berthet
La Tablle Ronde
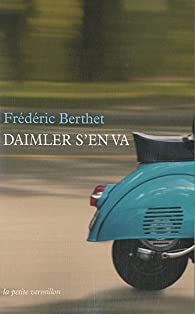
La vie est rouleau compresseur. N'importe laquelle, de vie. C'est une dégauchisseuse de l'espoir. Un rotovateur sans pilote dans un jardin anglais. Une machine motorisée qui avale tout sur son passage, y compris le passage. Elle défait méticuleusement tout ce qu'elle a fait, mâchant la poésie d'être au monde entre des dents de carbone, au milieu d'un nuage bleu acier et d'une odeur d'essence brûlée. Au final, elle explosera jusqu'au sentiment d'avoir vécu. Jusqu'au dernier reflet du dernier miroir pourtant déjà fêlé.
Prenez un Homme ! Pas n'importe lequel, mais un Homme perclus de sentiments et d'inquiétudes qui prend tous les événements, tous les éléments, toutes émotions en pleine figure. Et ce tout le temps. Et jour après jour. Lieu après lieu. Fragment après fragment. Peu importe qu'un tel homme soit détective, à moins que... Bref. Prenez-le, sortez-le du bain tiède de son existence et secouez-le vigoureusement. Que croyez-vous qu'il en tombera ? Des os brisés, des organes flétris, des heures amuïes, des images furtives, des mots, des mots, des mots... Tout cela certes, et plus encore si affinités. Mais tout cela, brisé. Brisé et rebrisé encore. Amenuisé jusqu'à la poudre, à l'esprit de vin, l'antimoine, la cendre ultime répandue dans l'azur et le vide à venir, qui sont notre commun linceul.
Non, personne ne connaît jamais personne. La lettre d'adieu à l'ami considérable le laissera plus stupéfait que mélancolique. Corps et âme saint-sébastiannisés de paroles légères et de souvenirs ailés, celui-ci planera un instant au-dessus de lui-même comme au-dessus d'une scène de crime, un accès de sincérité auréolant son visage. Rendu au sol il ne pourra pourtant que remuer ses propres doutes et comptabiliser ses abattis. Ultime sourire reliant l'espace des morts et celui des vivants, il aura peut-être pour lui la même pensée que pour le disparu : Est-on jamais sûr, ici-bas, d'avoir une fois au moins éprouvé chacune des émotions offertes pas une vie humaine ? C'est un peu simpliste comme question. Un peu stupide même. Mais tellement humain, à la fin.
Parmi l'énumération nombreuse des Droits de l'Homme que la sagesse du XIXe siècle recommence si souvent et si complaisamment, Baudelaire déplorait deux oubliés de première importance : Le droit de se contredire, et le droit de s'en aller. Selon Daimler, donc, le droit de laisser tout ce bordel dans l'état où on l'a trouvé en arrivant et de foutre le camp. Partir, c'est-à-dire ne pas rester. Ne plus pouvoir rester parce qu'on ne le supporterait pas, d'en rester là. Celui qui sent les choses - toutes les choses - les habitudes et les êtres, les désirs et les devoirs, les joies et les peines comme autant d'hélices prêtes à vous découper en morceaux au moindre faux-pas, celui-là ne peut que partir plus tôt que les autres - tous les autres -. Il sait qu'il ne peut plus rêver. Qu'il ne veut plus en parler. Qu'il ne peut plus courir dans les parcs en brandissant des branchages avec Franz Kafka et que, surtout, il aurait un mal fou à l'écrire. Ce détecteur de vérité ne peut que s'en aller. Que sortir, un soir, et aller s'allonger dans la neige. Sur le chemin, il se répétera sans cesse « Je suis très déçu », « Je suis très déçu », « Je suis très déçu », mais avec un accent auvergnat ; CQFD. On dira que ça n'a pas de sens, mais qu'on nous dise, si quelque chose en a ? De fait, ce genre d'homme n'aime pas les transitions.
Prenez un Homme. Un autre, mais ce n'est pas grave. Il s'agit là de la même chose. Du même abîme ontologique. Du même chagrin sans fond ni pitié « C'est sur la peau de mon cœur que l'on trouverait des rides. Il faut se quitter déjà ? Ne me secouez pas. Je suis plein de larmes. »
UN PRIVÉ À BABYLONE
Richard Brautigan
Éditions 10/18
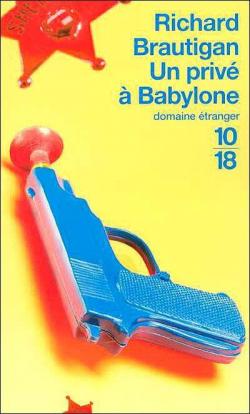
Parfois, on entre dans un livre comme un coupe-papier dans la chair vierge d’une enveloppe. Parfois, on rencontre une histoire comme on rencontre une personne et, parfois, on se met à l’aimer alors que cette dernière est déjà morte. Il faut bien avouer que les romans ont ceci en commun avec les cadavres, qu’ils ont été achevés dès avant qu’on ne les commente. La question qui reste, dès lors, dans l’amour comme dans la mort c’est de savoir ce que l’on va faire du corps ? Surtout lorsqu’il s’agit d’un crime. Heureusement, à San Francisco comme ailleurs, il y a des maisons et des gens pour ça. Des morgues, des détectives voire, des cimetières. En cherchant bien, on trouvera vite qu’un polar n’est bien souvent que la trajectoire d’un ou plusieurs personnages — morts ou vifs —, entre un point A et un point B. Entre un début et une fin. Entre un prétexte et ses conséquences. Mais parfois, ce n’est pas le cas. Outrepassant quelques lettres de l’alphabet (selon l’auteur le sumérien en compterait rien moins que 79 à savoir : autant que le livre a de chapitres ; Cqfd), il arrive donc que l’action comme son acteur en reviennent à la case départ, et sans avoir touché les 20 000 ni rien d’autre. Je ne sais plus qui a démontré par A + B que chercher et trouver avaient la même étymologie, et que dans les deux cas il s’agissait de circumambulation ? De tourner autour du pot. Dans cette histoire, le lecteur sera mené par le bout du nez entre le point A et le point A. Le point X et le point X, comme on voudra. Le truc, c’était de boucler une boucle comme on se serre la ceinture après une succession hasardeuse de réussites que l’on n’oserait imaginer qu’aux cartes, là où les possibilités ont beau être nombreuses, elles n’en demeurent pas moins quantifiables. Bref, ce qu’il faut bien comprendre ici c’est que, quand on met un pied devant l’autre dans une histoire sans queue ni tête, il ne faut pas s’étonner d’y devoir nager plus comme une pierre que comme un poisson. Du coup, on doit se contente de suivre le mouvement de l’eau, de faire la planche et, parfois, de rêver. De rêvasser, de surfer d’une phrase à l’autre, d’un personnage à l’autre, d’un fragment de nuit à l’autre tout en s’enfilant des bières et des aventures microscopiques renvoyant les romans de D. Hammett et de R. Chandler à l’art du haïku. Du coup (un autre), on peut arriver à comprendre comment, pour écrire un roman policier, il suffit de mettre un révolver dans les mains d’un personnage ou d’un autre, et d’attendre. De voir ce qui se passe. Après… Ben après, ça se passe. Le temps passe et puis c’est tout. Du point de vue philosophique, la concaténation est cet enchaînement nécessaire, ce lien logique qui met en rapport une cause avec son ou ses effets. Y a-t-il un Dieu, ou n'y en a-t-il point ? Y a-t-il un sens, n’y en a-t-il point ? Y a-t-il un point final, n’y en a-t-il pas ? Est-on contraint et forcé de trouver un moyen d'attacher et de sceller solidement dans le roc de l'évidence ce premier anneau, afin que tous les autres s'engendrent et se déroulent dans une suite logique et nécessaire d’événements reconnus comme tels ? Ah ah ! En voilà une question qu’elle est bonne. En tous les cas, du point de vue grammatical ou linguistique, l’opération consiste bel et bien à juxtaposer les symboles d'un alphabet voire – et c’est là que ça se corse – un « enchaînement de plusieurs parties du corps humain ». On croit qu’on s’égare, alors qu’on suit une logique. Une autre logique. Un pied devant l’autre, je vous dis !
Alors oui bon, une pute assassinée, un flic violent, un employé de morgue unijambiste, des noirs avec des rasoirs, une blonde richissime qui siffle des blondes sans jamais aller pisser, un chauffeur de blonde au cou de taureau, un père assassiné, un mendiant aveugle qui compte ses sous, une proprio qui croit au « brouillard de cactus » et au « pétrole dans le Rhode Island »… Bref, tout et n’importe quoi ça peut coller. Exactement comme dans la vie quoi. Sans réalisme aucun. Avec surréalisme même. Bref. Le problème, c’est juste que, parfois, il n’y a pas de balles dans le révolver (voir plus haut). Mais ça, ce n’est pas une autre histoire, mais le début du livre. La fin du livre, quant à elle, ne manquera pas de surprendre puisque, de suspens, au vrai, il n’y a point. Quoique, de retrouver sa propre mère au cimetière, après une nuit pareille, confondant les cercles de l’Enfer avec les prés carrés du Paradis, relèverait presque d’un fantasme pour psychanalyste en mal de sujet pour un article à paraître en 1942 ? Mais ça, pour le coup (encore un autre) c’est une autre histoire. Ou plutôt une différente histoire, une divergente histoire, une dérivante et fuyante histoire… et ce, pour ne pas avoir à répéter, dans la même phrase, deux fois le même mot. Mais je m’égare sans doute ?
VOUS SEREZ DES HOMMES MES PETITS FILS
Mireille Poulain-Giorgi
Éditions Jalon

Dans son dernier livre, Mireille Poulain-Giorgi fait l'éloge de la conversation entre les générations, en se faufilant avec malice dans la jungle des questions qui hantent l'esprit et le corps des petits enfants qui sont déjà, ou qui seront bientôt les nôtres. Si Victor Hugo vantait sans retenue « les fils de nos fils », qui « nous enchantent » car ce sont « de jeunes voix matinales qui chantent. », il faut bien avouer que, porté à la contemplation, il négligea les questions épineuses et, par voie de conséquence, les réponses éclairantes sur des sujets qui, il faut bien dire, n'étaient pas de son époque. Dans ce dialogue affectueux et pédagogique avec ses petits-fils, l'autrice dénoue les liens du genre et du patriarcat sous les auspices de Françoise Héritier, auquel ce livre rend un hommage marqué à toutes les pages ou presque. Prônant un féminisme aussi volontaire que souriant, le livre vient gentiment faire la nique aux questions cruciales de notre époque, et qui ne fâcheront que les fâcheux. L'Art (moderne) d'être Grand-Mère est un art comme les autres.
EDEN SPRINGS
Laura Kasischke
Le Livre de Poche

C’est quoi au juste, le paradis. Est-ce le lieu du bonheur, de la perfection, de la joie ? Est-ce la sortie de l’existence, l’accomplissement des désirs, le goût sans fard de l’interdit ? Est-ce tout simplement l’espace-temps de l’immortalité ? Ou bien alors, plus simplement, une manufacture sournoise de l’oubli ? Une face bien cachée de l’inanité même du bonheur, de son mensonge curatif, de ses reflets accumulés en ruines aux pieds de l’Ange de l’Histoire, dont le visage sourit, mais dont le corps se termine en queue de dragon ?
Les premiers colons « américains » comme les derniers, ont sciemment confondu le « nouveau monde » avec la terre promise, avec le paradis perdu, avec l’utopie chrétienne apocalyptique. Ils ont agi de l’esprit de conquête comme d’une indulgence religieuse. Ils ont voulu croire qu’ils étaient les mêmes devant les Hommes et devant Dieu. Ils ont voulu croire qu’une rémission partielle ou totale des pénitences pendait au cou de leurs pires méfaits. Que puisqu’ils étaient déjà au royaume de Dieu, les fautes commises leur seraient comme par magie illico pardonnées. À ce jeu-là, les vainqueurs auront toujours été les mêmes. Il y aura toujours eu un homme, grand, beau, séduisant, manipulateur et vêtu de blanc pour prophétiser le retour du Messie et de sa promesse d’immortalité. A cet homme-centaure, fut-il monté sur ressorts ou sur talonnettes, rien d’impossible. Établir un ranch en s’appropriant les terres des Autochtones. Modifier la matrice écologique aux dimensions de son profit. Piller les ressources d’autrui. Faire la guerre à l’autre bout du monde. Régenter l’ordre mondial ou du moins le croire… À tout le moins, au fin-fond du Michigan en ce début du XXème siècle, former une secte religieuse où l’on monte des attractions foraines, et où l’on vend des hotdogs avariés.
Tout peut devenir bénéfice aux yeux d’un tel entrepreneur, y compris lorsque sa matière première est l’humaine nature, et que la misère, la frustration où les peurs enfantines durent longtemps qui, tels des animaux blessés, viennent s’abreuver au marigot de la croyance aveugle et de la fausse providence. L’oubli des fautes passées est un sport national aux Etats-Unis. Et les étoiles du non-dit sont mille fois plus nombreuses que celles du drapeau national. C’est un puits sans fond où brûlent toutes les fautes, tous les abus, tous les crimes des générations présentes, passées voire à venir. Son cercle noir vibre en gésines dans les fondations mêmes de cette nation, que l’on appelle, peut-être à tort « Amérique », et qui a fait de la prédation du monde, de règnes végétaux, animaux et humains une manne céleste et terrestre à la fois.
Symboliquement, tragiquement, indescriptiblement si les jeunes femmes et si l'enfance sont des fruits mûrs que l’on cueille sans vergogne dans les allées fleuries d’un Printemps perpétuel, c’est bien qu’il y a quelque chose de pourri, au sein de ce fameux paradis. C’est bien la preuve que son horizon, son ultime frontière n’est qu’un sabre sanguinolent. Au pays du tout est possible, les abuseurs sont roi, et les abusés légion.
Si notre besoin de consolation est impossible à rassasier, le roman de Laura Kasischke démontre quel peut en être le sombre prix. Qu'est-ce que le paradis ? Que sont les Etats-Unis ? Parfois c'est un fragment d'histoire. Un détail sur une carte postale. Un oubli. C'est le monde entier dans un seul grain de sable. Un grain de sable tombé dans la grande horlogerie. L'anatomie d'un fait d'hiver, du côté de Benton Harbor, Michigan.
